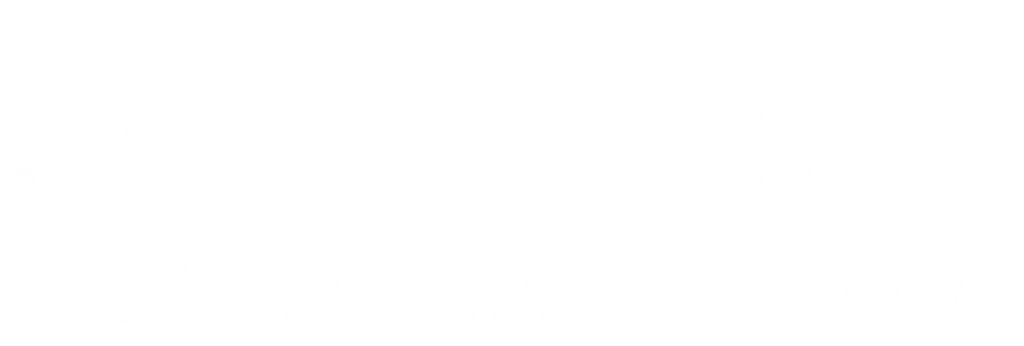Un lien naturel avec l’Université Laval
Jeune étudiant, Jean-Paul Laforest s’intéresse à la biologie, mais cherche une formation couvrant une plus grande diversité de domaines. C’est alors qu’il découvre le programme d’agronomie à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) de l’Université Laval, le seul offert en français au Canada. Économie, sols, géologie, plantes, animaux et environnement : le savoir qui s’ouvre à lui le passionne aussitôt.
Son baccalauréat en poche, il décide de poursuivre aux études supérieures en complétant une maîtrise en sciences animales à l’Université Laval, puis un doctorat à l’Université de Guelph, en Ontario. Il y rencontrera Lynn Hammell, sa future conjointe et mère de leurs trois filles, également agronome en sciences animales.
M. Laforest revient à Québec en 1986 pour enseigner à l’Université Laval. Mme Hammell l’accompagnera et mènera une carrière fructueuse au gouvernement du Québec. À la FSAA, M. Laforest devient directeur du Département des sciences animales, puis doyen de la Faculté pendant plus de huit ans. Il termine sa carrière universitaire au vice-rectorat aux ressources humaines, comme adjoint à la vice-rectrice puis vice-recteur adjoint. Il a l’honneur et le plaisir de « reprendre du service » pour deux années supplémentaires à titre de doyen par intérim de la Faculté des sciences infirmières.
Dans ses mandats professionnels et bénévoles à l’Université, M. Laforest a toujours eu cette conviction que les grandes réussites sont le fruit des relations humaines qui s’y créent. « J’ai fait des rencontres marquantes qui ont tracé mon parcours, raconte-t-il. Une université est la somme des gens qui la composent et la font évoluer. On ne fabrique pas des machines, on fabrique du savoir, et ce savoir vient toujours de l’humain. »
L’avenir des sciences animales
Ayant tous deux été agronomes, M. Laforest et Mme Hammell voient dans les sciences animales des défis complexes dans un contexte d’augmentation de la population mondiale, pour nourrir la planète tout en préservant l’environnement. « Appliquer les connaissances actuelles ne sera pas suffisant, il faut viser l’innovation, affirment les donateurs. Les études supérieures deviennent alors essentielles et avec elles le soutien financier, pour attirer une relève qui a soif d’approfondir ses connaissances et de faire évoluer la science. »
Soutenir l’implication étudiante
Le couple a fait le choix d’orienter son projet philanthropique vers des bourses d’études. Ils planifient alors la création du Fonds Jean-Paul-Laforest-et-Lynn-Hammell en sciences animales, qui récompensera des étudiantes et étudiants impliqués pour améliorer le bien-être de leur communauté.
Diplômés des cycles supérieurs, M. Laforest et Mme Hammell sont conscients du fardeau financier que ces études peuvent entraîner. Ils sont aussi persuadés que l’implication active dans son milieu mérite d’être encouragée au même titre que l’excellence scolaire. « On doit encourager les jeunes à garnir leur parcours universitaire d’expériences enrichissantes, sans se limiter aux salles de classe, explique Mme Hammell. Il faut former des professionnels, mais surtout les aider à devenir des citoyens engagés et de meilleurs humains. » Pour M. Laforest, à qui l’Université a ouvert les portes d’une belle carrière, les professeures et professeurs ainsi que les membres de la communauté sont les premiers témoins des bénéfices de la philanthropie. « Par leur contribution, ils ont le pouvoir de devenir des modèles pour la collectivité », avance-t-il.
Le don comme investissement
Mme Hammell et M. Laforest ont traduit leur engagement par le don d’une assurance vie, car ils y voient un effet levier pour faire fructifier leur geste. « C’est un investissement pour donner davantage que ce qu’on aura versé, précise Jean-Paul Laforest. La capitalisation du fonds permet de le rendre pérenne, avec des sommes qui reviendront annuellement sous forme de bourses. »
Et pour Lynn Hammell, il n’est pas question de priver les siens. « Au contraire, ça amène des discussions intéressantes sur ce qu’on souhaite léguer comme valeurs à nos enfants, ajoute-t-elle. Ce sont eux qui verront les retombées positives de notre geste : n’est-ce pas là l’essence même de la philanthropie ? »